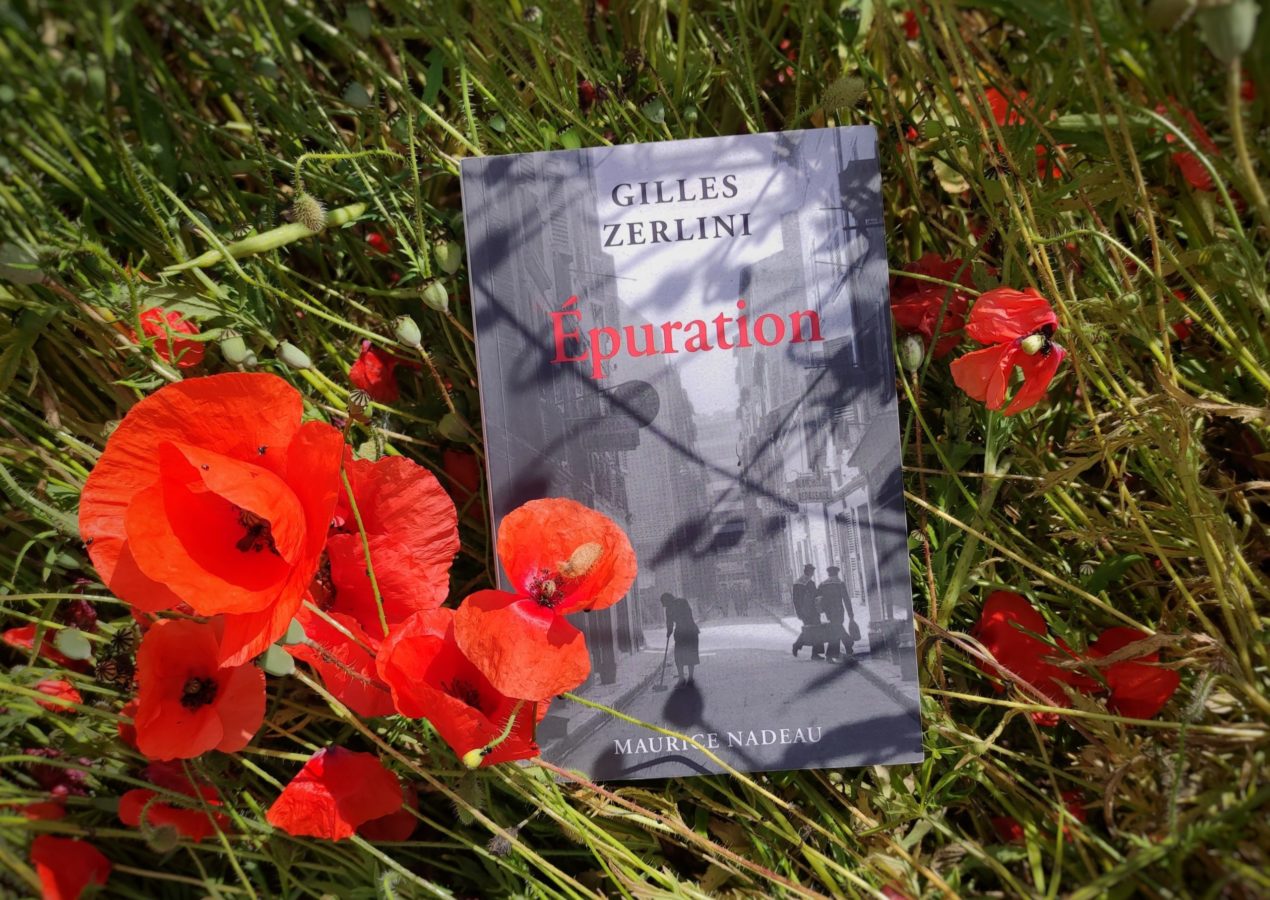Souviens-toi de cette île où l’on bâtit le feu,
De tout olivier vif au flanc des crêtes,
Et c’est pour que la nuit soit plus haute et qu’à l’aube
Il n’y ait plus de vent que de stérilité.
Tant de chemins noircis feront bien un royaume
Où rétablir l’orgueil que nous avons été,
Car rien ne peut grandir une éternelle force
Qu’une éternelle flamme et que tout soit défait.
Pour moi je rejoindrai cette terre cendreuse,
Je coucherai mon coeur sur son corps dévasté.
Ne suis-je pas ta vie aux profondes alarmes,
Qui n’a de monument que Phénix au bûcher ?
Y. BOnnefoy, “Une voix”, Section III “Douve parle”, Du mouvement et de l’immobilité de douve, Gallimard, 1953, P.87.
Épuration dessine la carte d’un territoire niellé dans les corps et se fait l’écho d’un chant : celui d’une identité collective.
Jeune vétéran de Verdun, Louis Germani retourne dans sa Corse natale, rapportant des tranchées la médaille des blessés de guerre et une démarche claudicante.
Un soir de San Mamilianu, il rencontre Félicité, une jeune fille d’un village voisin. Emporté par la spiritualité des lieux comme par la fougue d’après-guerre, il la prend là, à même le parvis de l’église. Bientôt, c’est toute l’île qu’ils honorent de leur amour, avant de partir élever leurs enfants à Toulon.
Les mots du roman prennent chair et, de leur frottement, surgit l’organe palpitant de la Basse-ville. Dans cet espace clos, s’épanouit toute une faune qui maraude dans les jardins publics ou polissonne au quartier de la Visitation, tandis que survient l’Occupation. Entre labeur et plaisir, Louis multiplie les rencontres et fait la connaissance de Marie Fabiani, tenancière de bordel. Au fil des jours, une amitié teintée d’amour naît entre l’égoutier et la prostituée, pour laquelle il rabat des clients.
À la manière des grands récits du XIX° siècle, Gilles Zerlini met au-devant de la scène romanesque forçats de l’existence et autres « déclassés » : prostituées, soldats, marins, ouvriers … qui cherchent tous de quoi combler un insatiable appétit de vivre. L’arrivée des Alliés vient bouleverser leur quotidien, changeant dans son sillage la couleur des uniformes. Les amis de naguère deviennent les ennemis à abattre et Louis, comme d’autres, est bientôt rattrapé par l’Histoire.
Ce que La Fille Karamazov en a pensé
Il existe chez Gilles Zerlini un véritable désir de re-territorialiser la parole narrative. Sur les trente-quatre chapitres que compte son roman, dix d’entre eux font explicitement référence à des lieux, tous liés à une expérience intime. Quartier (« Rodeilhac »), détail topographique (« Le Las »), architecture ou partie d’icelle (« In qua nocte tradebatur ») … l’espace romanesque, quoiqu’essentiellement circonscrit à la Méditerranée, se laisse parcourir tout autant qu’il nous traverse, imprimant en nous une certaine présence au monde.
À l’inscription matérielle du texte dans la ville de Toulon, se superpose une géographie intellectuelle de la Corse, présence invisible demeurant l’ancrage spirituel du récit. En cela, la démarche ontologique de l’auteur se rapproche de celle du poète Yves Bonnefoy, « inséparable d’une inscription géographique, au sens le plus large du terme 1 ». Pourtant brièvement évoquée au début du roman, la Corse figure un espace matriciel dont les contours se profilent derrière chaque lieu sillonné par les personnages. De Toulon, le narrateur saisit l’insularité avec acuité, apposant sur la ville l’image d’un autre territoire : « C’est une ville close, une sorte d’île sise au milieu d’une terre hostile, on l’a d’ailleurs entourée de forts. Peut-être est-ce pour cela qu’ici le sentiment d’appartenance est si prégnant, comme sur l’Île, Toulon est une île, un clos, un retranchement.2 ». De même lorsqu’il décrit la Basse-ville, rendue semblable à une enclave corse par le partage d’une langue et d’une culture communes : « Dire que la Basse-ville fut une ville corse n’est pas exagéré ; on entendait ici toutes nos langues3 … ». L’Île forme donc un horizon indépassable, en particulier pour les corps qui appréhendent l’espace selon cette terre originelle : « Chez nous, tout est fleuve avec quelque nuance selon leur taille. Est-ce de vivre sur une île qui nous fait nommer ainsi ce qu’ils appellent ailleurs ruisseau, montagnes les collines et villes de bien modestes bourgs, est-ce ce territoire engoncé qui nous fait pressentir chaque vallée comme un pays et notre isolat comme un continent ? 4 ».
La question du corps et de son déploiement, notamment dans l’espace urbain, vient sous-tendre cette spacialisation du récit, faisant de Gilles Zerlini un auteur de la corporéité. L’écrivain interroge les mécanismes ayant conduit à déserter progressivement les lieux publics, au rythme d’une dématérialisation globale rampante : « L’espace public était autrefois bien plus investi qu’aujourd’hui, l’urbanité était un mode de vie, une part du corps de chacun. […] La vie s’étendait au dehors des maisons, que d’aucuns nomment désormais des appartements.5 ». Refusant l’hygiénisme d’une société qui récuse à la chair son droit de cité, le roman célèbre l’incarnation dans toute son imperfection, ou plutôt dans toute son humanité. Épuration chorégraphie les mouvements des corps en soif d’épanouissement et restitue avec une grande sensualité leur promiscuité, leur moiteur, leurs odeurs : « Au moins, il n’y a pas de courant d’air, il n’y a même pas d’air du tout en fait, les odeurs et les miasmes de la chaleur humaine, de la fumée et des fritures restent.6 ». Ce n’est plus tant l’héroïsme des personnages, mais leur humanité, avec tout ce qu’elle comporte de fragilité, qui est mise à l’honneur. De tous les protagonistes du récit, la prostituée en est sans doute le symbole le plus sensible, elle qui érige son corps en rempart contre la souffrance du monde.
Mais si le franchissement de l’espace dynamise la trajectoire des personnages, ces derniers semblent parfois exilés, tant ils aspirent à retrouver leur « pays natal ». Mûs par un fantasme de fusion qui signerait, non pas leur anéantissement, mais une forme d’accomplissement, par un retour aux racines mêmes du monde, les personnages sentent vibrer en eux l’appel d’une terre promise : « Ces jours de Mistral, il rêve d’écarter les bras et de se laisser emporter, comme les oiseaux de la mer qui savent en jouer, se laisser aller, comme un pétale léger de ciste, de traverser la mer qui sépare la Provence de la Corse et, une fois le vent couché, de se poser là-bas sur la tombe des siens, comme on s’endort au ventre chaud d’une femme, repu, épuisé, et enfin se mêler à eux dans une communion de chair et de végétaux, dans le grand pourrissement commun, qui fait ou fera de nous une part du tout, de terre, de poussière. De cette terre d’où nous fûmes extraits et où nous retournerons, de toute manière.7 » .
Le roman se fait célébration de la terre ancestrale comme objet de désir. L’île prend les contours d’un jardin paradisiaque originel, agissant comme un révélateur de notre humanité. Les villages corses, dont sont originaires Louis et Félicité, sont un havre de paix retrouvé après les horreurs de la guerre. Les personnages y font l’expérience d’une harmonie totale avec la nature qui les accueille, témoin vivace de leurs unions : « Pour sûr, ils s’aimèrent. Ils firent de chaque lieu du pays une chambre d’amour. […] Ils construisirent des lits de mousse ou de feuilles tendres, des nids. […] Ils s’aimèrent partout, souvent dans les jardins potagers, au mieux. Cachés parfois dans les bois ou les grottes.8 ».
Cette vision de la Méditerranée, empreinte de l’imaginaire biblique, n’est pas sans rappeler l’héritage du locus amoenus dans la littérature médiévale. Gilles Zerlini décrit un paysage bucolique, verdoyant et ombragé, qui offre un écrin protecteur aux étreintes des amants, métaphores de l’activité procréatrice de la nature : « Comme on le dit dans les contes, « ils eurent beaucoup d’enfants ». Ça oui, une douzaine en tout ou presque, il me plaît ici d’égrener leurs noms9 … ». Le paysage corse, entre vallées et montagnes, offre au regard un mouvement ascensionnel qui invite les personnages au voyage initiatique. Tout à la fois berceau de leurs amours et mégalithe de leurs aïeux, c’est un espace total où la vie et la mort s’interpénètrent : « Ils mêlèrent leurs semences plusieurs fois et s’endormirent couverts de lune, couchés au-dessus des centaines d’ossements de la fosse commune de cette église, sans en savoir rien. On dit que là, sous le pavement, reposent les victimes de l’épidémie de la Calcagnetta […] Au-dessus […] de cet ossuaire, ils passèrent la nuit à s’aimer.10 ».
Les déambulations au sein de ce territoire réel et fantasmé dévoilent la quête mémorielle du narrateur. Benjamin écrivait que « La rue conduit celui qui flâne vers un temps révolu. Pour lui, chaque rue est en pente, et mène, sinon vers les Mères, du moins dans un passé qui peut être d’autant plus envoûtant qu’il n’est pas son propre passé privé.11 ». À la manière du flâneur, l’expérience de l’espace favorise l’émergence du souvenir. Si le roman se prête à une réhabilitation de Louis Germani, tentant en cela d’effacer les injures de l’Histoire, le lacis des destins fait entendre une voix chorale, rappelant l’importance d’une communauté organique créatrice et porteuse de patrimoine. En racontant l’histoire de Louis, le narrateur tend un miroir grossissant à notre société repue, à en éclater, d’individualité. Renaît alors tout un mode de vie oublié depuis, épuré par une modernité à marche forcée. La nostalgie est palpable, parfois légèrement teintée d’acrimonie, à l’évocation de ce que furent Toulon et plus largement la vie, en cette période d’après-guerre : « Aujourd’hui, la Basse-ville est un no man’s land, le quartier de la Visitation un souvenir, en ces temps incertains qui voient l’identité érigée en valeur, la nation s’est effacée et le projet collectif, basé sur un idéal républicain, s’est amoindri12 … ».
Affleure ainsi toute la dimension poétique du roman qui laisse retentir une culture immémoriale. La structure même de l’œuvre nous renvoie à la tradition orale, faisant songer aux chants, ces longs poèmes en vers hérités de l’Antiquité. Gilles Zerlini déconstruit la forme canonique linéaire et chronologique du récit en concevant ses chapitres comme des fragments. Épuration est à l’image du Las, ce cours d’eau situé à l’ouest de Toulon : « […] capricieux, [il] chang[e] de lit et chang[e] de cours, [il] cré[e] de nouvelles circonvolutions, dans[e] un petit peu, oubli[e] [ses] promesses et tend des pièges aux hommes, invent[e] des îles et en englouti[t] d’autres13 … ». À de nombreuses reprises, le narrateur revient sur ses pas pour retracer l’histoire d’un personnage ou explorer ses souvenirs. Souvent, le retour en arrière est l’occasion de développer un passage déjà ébauché ou de lui apporter des précisions, comme si la réflexion s’en trouvait mûrie, après avoir « reposé » pendant plusieurs pages. D’autres fois encore, le narrateur semble perdre le fil de son récit qu’il entrelace de pensées, chansons, anecdotes et autres historiettes, toutes d’apparence digressive, mais qui ouvrent le roman sur une respiration bienfaisante.
Pour Gilles Zerlini, le langage dépasse le simple étiquetage du monde, mais permet d’en saisir la présence vivante, tout en ressuscitant un univers englouti. L’auteur fait jaillir la beauté de son territoire, sans en taire la noirceur, d’un ton parfois facétieux voire cru, mais toujours avec une grande tendresse pour ses personnages. Sa langue revêt le sceau de l’image, se peuple d’analogies, de comparaisons ou de métaphores. Elle emprunte sa matière aux Écritures et aux œuvres antiques, tout en laissant s’exprimer le folklore populaire. Elle s’incarne, nous donne à savourer l’épaisseur de ses mots, que le narrateur ordonne quelquefois en constellations, telles ces listes généalogiques qu’il prend plaisir à égrener, avec la délectation de celui qui ramène les morts à la vie, par la simple évocation langagière.
On n’écoute finalement guère le « moi » du narrateur, qui souvent s’efface et fluctue, préférant apostropher le lecteur ou faire entendre d’autres voix que la sienne, manière de rappeler « Une façon de dire, qui ferait / Qu’on ne serait plus seul dans le langage14 ».
Le mot de la fin
Œuvre profondément vivante, Épuration « émeut, vit, germe à travers une espèce de délabrement qui ne laisse debout que certains moments, lesquels en sont à proprement parler les sommets.15 ». Les trajectoires s’y entrecroisent et les petites histoires se heurtent à la grande, rappelant, au besoin, l’absurdité de nos existences. Si le lecteur n’appréhende pas toujours les ramifications des chapitres dans l’immédiateté de la lecture, il en saisit les éclats, comme cette robe rouge, tache incarnate sur la rétine, qui cristallise à elle seule les destins de Marie et de Louis.
Ce livre, qui n’a de roman que l’appellation, réverbère les lointaines voix de la mémoire. Porté par la vigueur d’une langue tournée vers l’oralité, il se mue en héraut d’une culture évanescente.
Dès lors, Gilles Zerlini renoue avec l’art de raconter, se faisant davantage aède que romancier. Il puise son savoir de l’expérience, vécue ou transmise, pour enraciner son roman dans une terre ancestrale, manifestant de la sorte une autre façon d’habiter le monde, comme le ferait un poète.
« La poésie doit être la parole qui garde mémoire de cette plénitude originelle et en poursuit la trace, à travers les lieux du monde réel où elle est encore sensible. Ainsi a quelque chance d’être sauvée la force vive de l’immémorial, la beauté intacte de ce qui, dans le temps, échappe au temps et témoigne de l’éternel. »
H. FERRAGE, Philippe Jaccottet, le pari de l’inactuel, Paris, PUF, 2000, P.169.
Épuration de Gilles Zerlini, éditions Maurice Nadeau, avril 2021, 155p. 18€
1 Y. Bonnefoy, Poèmes, préface de J. Starobinski, Gallimard, collection « Poésie », 1982.
2 G. Zerlini, Épuration, Maurice Nadeau, avril 2021, p.9-10.
3 Ibid., p.70-71.
4 Ibid., p.38.
5 Ibid., p.79.
6 Ibid., p.77.
7 Ibid., p.10.
8 Ibid., p.13-14.
9 Ibid., p.16.
10 Ibid., p.12-13.
11 W. Benjamin, « Le flâneur », Paris. Capitale du XIX e siècle, Cerf, 1990, p. 434-435.
12 G. Zerlini, Épuration, Maurice Nadeau, avril 2021, p.71.
13 Ibid., p.37.
14 Y. Bonnefoy, “II. Le tout, le rien”, Ce qui fut sans lumière suivi de Début et fin de la neige et de Là où retombe la flèche, Gallimard, collection « Poésie », 1995, p.140.
15 R. Barthes, « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », Œuvres complètes, t. V, p. 344.