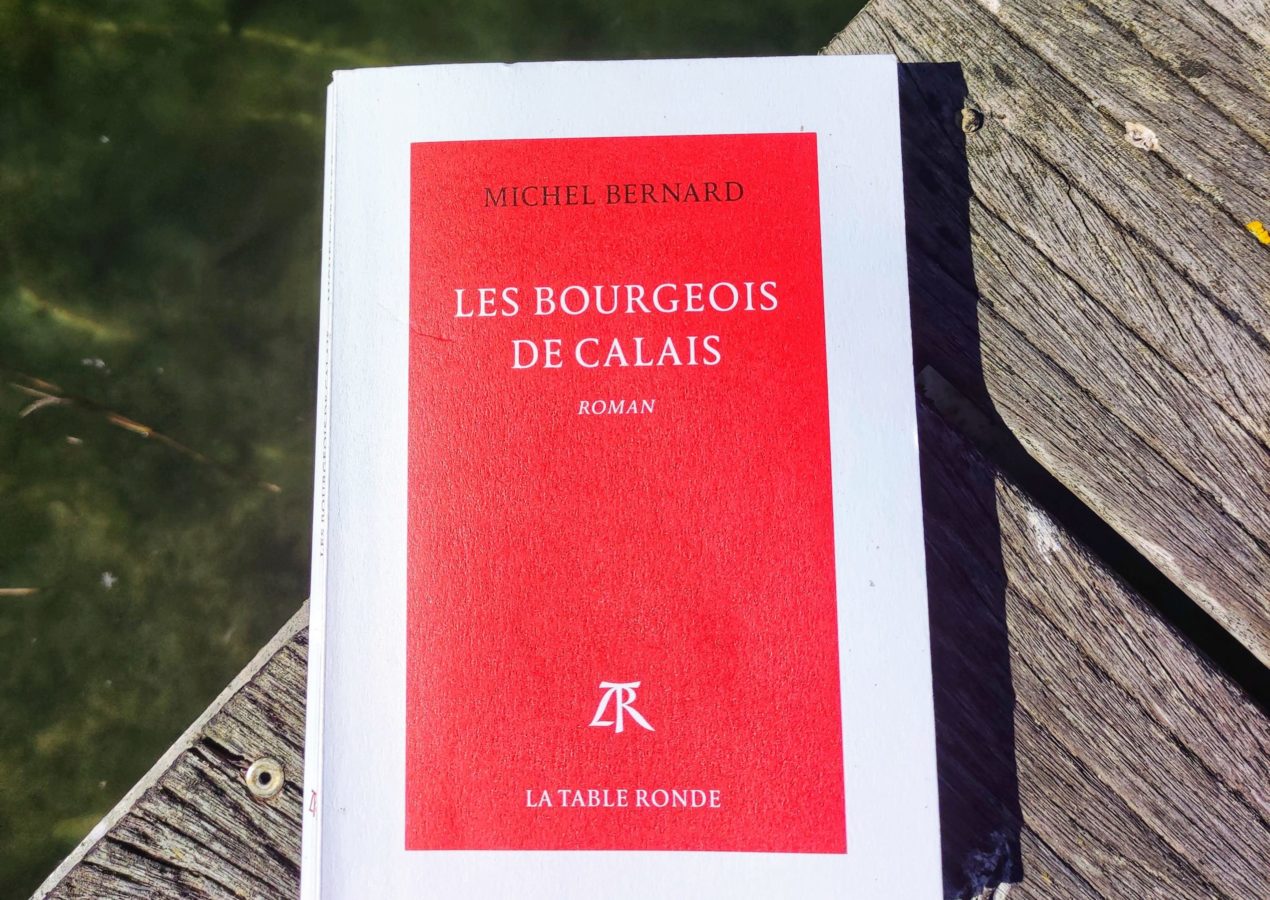« Toute figure est un monde, un portrait dont le modèle est apparu dans une vision sublime, teint de lumière, désigné par une voix intérieure, dépouillé par un doigt céleste qui a montré, dans le passé de toute vie, les sources de l’expression. […] Vous êtes devant une femme et vous cherchez un tableau. Il y a tant de profondeur sur cette toile, l’air y est si vrai, que vous ne pouvez plus le distinguer de l’air qui nous environne. Où est l’art ? perdu, disparu ! Voilà les formes mêmes d’une jeune fille. […] Oui, mon ami, […] il faut de la foi, de la foi dans l’art, et vivre pendant longtemps avec son œuvre pour produire une semblable création. »
Balzac, Le Chef-d’oeuvre inconnu, GF-Flammarion, 1981, P.48-50.
Nord, 1884. Un vent de progrès souffle sur Calais. Aux abords de la vieille ville, la commune de Saint-Pierre, excroissance spongieuse en périphérie ouvrière, ne cesse de s’étendre, sans plus masquer son désir d’absorber en son sein l’ancienne cité bourgeoise. Avant l’inévitable fusion administrative, Omer Dewavrin, maire de Calais, brûle d’honorer la grandeur de sa ville et de laisser derrière elle un témoignage vivace de son identité, à l’épreuve du temps et de la modernité.
L’approche du centenaire de la révolution lui fournit un prétexte : il fera ériger un monument en hommage aux Bourgeois de Calais, qui s’étaient soumis tête et pieds nus, sans chemise et la corde au cou, à Henry III, roi d’Angleterre, mettant ainsi fin, par leur héroïsme et leur courage civil, à onze mois de siège et de privations.
Sur les conseils d’un ami peintre, Omer Dewavrin se rend à la capitale pour y rencontrer un jeune sculpteur, Auguste Rodin. Alors que Tout-Paris considère ses oeuvres d’un oeil soupçonneux, encore hermétique à son génie, et bruisse du camouflet de l’ « Âge d’airain » ; sa virtuosité à saisir les mouvements de l’âme à travers ceux du corps pour révéler toute la profondeur de la nature humaine bouleverse le maire qui lui confie la réalisation du projet : l’aventure des « Bourgeois » est lancée.
Si la première maquette de Rodin conquiert le comité d’érection du monument, la seconde, plus proche des aspirations artistiques du sculpteur, soulève en revanche la défiance. Pourtant soutenu par son commanditaire, Rodin s’entête et affirme une philosophie artistique révolutionnaire pour l’époque : ses « Bourgeois de Calais » pénétreront « les vérités intérieures sous les apparences1 ».
Roman d’une amitié inattendue née des échanges entre Rodin et Omer Dewavrin, Les Bourgeois de Calais raconte l’incroyable genèse d’une sculpture retenue dix ans dans son atelier par les chahuts du hasard, et célèbre l’empire d’une œuvre qui rend possible la communion des hommes, enfin réunis dans un instant de grâce.
L’avis de La Fille Karamazov
Il est des écrivains transportés, des funambules littéraires qui oscillent, d’avant en arrière, cherchant leur équilibre entre une ferveur quasi mystique et une impérieuse obsession. Ceux-là tournent autour de leur axe, dont ils s’éloignent puis se rapprochent, petit point d’abord imperceptible se faisant de plus en plus lumineux. Michel Bernard est de cette étoffe.
Nourri par la lecture des grands chroniqueurs, de Jean Froissart à Jules Michelet, Michel Bernard file l’écriture d’une Histoire de France à laquelle se mêlent étroitement sources officielles et expérience plus intime du récit national. Sous sa plume, l’Histoire prend vie. Comme l’Omphale de la tapisserie, elle se décolle de la toile de fond romanesque et, de ses gracieux mouvements, nous invite à la rejoindre pour esquisser quelques pas, d’une saltarelle assurément, au rythme emporté par le retour et la variation des mêmes figures mélodiques.
Dans le panthéon personnel du romancier, se dessinent les silhouettes de celles et ceux qui ont fait l’Histoire, qui l’ont subie, aussi. Figures de proue des manuels scolaires ou petites gens tombées dans l’oubli, les deux pieds bien enracinés dans un territoire longtemps parcouru et toujours célébré par l’auteur, toutes ont en commun cet élan, cette force intérieure qui les projette vers l’inconnu. Et c’est bien de cette aspiration vers l’inconnu dont il est question dans son dernier roman, Les Bourgeois de Calais.
Michel Bernard tire ainsi du néant six figures légendaires du bas Moyen-âge à l’origine d’une des plus célèbres sculptures de Rodin et fait découvrir au lecteur les tâtonnements, les hésitations, les recommencements mais aussi les visions tranchantes d’un artiste frappé par la vigueur d’une chronique médiévale aux sonorités oubliées, à la fois proches et lointaines.
Dans la lignée des grands romans réalistes français, Les Bourgeois de Calais fait renaître un XIXe siècle en plein essor urbain. La ville y devient le lieu de tous les possibles. Calais, d’abord, tirée de son assoupissement par le chantier portuaire, conséquence directe de la fusion administrative avec la commune de Saint-Pierre. Paris, ensuite, dont la rumeur et la sève sont rendues avec brio dans de nombreuses scènes du quotidien. C’est toute l’atmosphère des cafés et des gargotes du XIXe siècle que Michel Bernard recrée, offrant un écrin sonore et vivant à l’amitié naissante entre Rodin et son commanditaire, Omer Dewavrin : « C’était un mastroquet fréquenté du petit personnel des administrations nombreuses dans le quartier, des cochers et des artisans. […] La salle à manger enfumée était comme meublée d’une odeur de graillon, de laine, de vin et de cuir mouillé flottant sous le plafond bas. Le sculpteur, en habitué, avait sa table contre une fenêtre. […] Dans ce réduit à mangeaille parisien, [M. Dewavrin] s’efforçait de dissimuler au sculpteur les répugnances de son nez et les contractions de son estomac. […] Les gens mangeaient sans dire un mot, mais le bruit des mastications, des verres heurtés, les commandes à voix fortes, parfois exaspérées, peuplaient l’endroit de cette pesante humanité des grandes villes qui se resserre aux premiers froids2. ».
Pourtant ancré dans la Belle Époque, le roman ouvre une croisée sur la mémoire médiévale calaisienne, mettant ainsi en scène, telles des herbes folles qui jailliraient entre des pavés disjoints, le surgissement du passé au sein d’une modernité galopante. L’illustre reddition des Bourgeois de Calais, figée dans notre mémoire collective en une vignette colorée, vient alors questionner notre rapport à l’héritage mémoriel et à ce que nous faisons de notre Histoire, de tous ces grands jours parvenus jusqu’à nous à travers le prisme des chroniqueurs du temps jadis ou l’écho de voix familières, le soir, à la veillée.
En philosophe, Michel Bernard interroge la permanence du même dans la marche du Temps : qui sommes-nous, réellement ? Comment être encore soi-même quand tout change autour de nous et qu’on ne se reconnaît plus ? Comment concilier modernité et héritage mémoriel, sans s’abandonner aux bras décharnés d’un passé ectoplasmique, ni se perdre dans l’illusion d’un futur holographique ? Le romancier tresse la périlleuse fibre de l’attachement au passé et l’entrelace au mouvement de la vie, prenant garde de ne pas transformer sa toile en rets.
À la fois résolument tourné vers l’avenir et sentinelle d’une Histoire qui, chaque jour, se dérobe davantage, le personnage d’Omer Dewavrin incarne la tension entre deux mondes antinomiques. En homme politique avisé, le maire de Calais admet l’inéluctable fusion avec Saint-Pierre et se soucie de l’accompagner au mieux, « […] convaincu pour sa part que le statu quo n’était plus tenable, qu’il fallait adapter les institutions pour ne pas subir l’avenir, mais en tirer profit dans l’intérêt commun3. » ; mais il demeure cependant profondément attaché à un passé qu’il craint de ne pouvoir totalement protéger : « La mélancolie le rattrapait toujours à cette heure, celle de la sortie de l’étude quand il était pensionnaire. L’ombre des remparts s’étirait sur l’eau. Ces vénérables maçonneries militaires n’en avaient plus pour longtemps. Les arbres du chemin de ronde avaient été coupés et bientôt les vestiges des fortifications seraient arasés. La dynamite et les pioches achèveraient l’œuvre du temps ; on se verrait d’une agglomération à l’autre par-dessus le canal. Calais et Saint-Pierre ne feraient bientôt qu’un4. ».
Dès lors, plus qu’un monument, c’est une relique d’un passé glorieux, un talisman pour se prémunir de l’oblitération qu’Omer Dewavrin ambitionne en premier lieu d’offrir à sa ville. Délicatement, le roman laisse affleurer les doutes d’un personnage que chaque rencontre avec Rodin vient davantage ébranler. Les voyages en train de l’édile, entre Calais et Paris, métaphorisent son cheminement spirituel et favorisent l’exploration de son univers intérieur. Le littoral, la campagne calaisienne, la plaine picarde, la vallée de la Thève, la forêt de Chantilly… Michel Bernard n’est pas scénographe : il ne cherche pas à produire un effet de réel factice en créant des décors de carton-pâte. L’écriture rend palpable un amour authentique de la terre et un certain souci du terroir, qui transparaissent dans chaque déambulation des personnages. Avec générosité, elle donne à voir les détails picturaux d’un « Tableau de la France », à travers le regard contemplatif de ceux qui la parcourt. Le romancier procède par petites touches de couleurs, laissant sa juste place à la lumière, comme le feraient ces impressionnistes qu’il admire tant : « Après la vallée de l’Oise, les fermes éparpillées dans la campagne, les localités traversées par le chemin de fer étaient bâties en briques. Les gares aussi. Dans la dentelle urbaine rougeâtre qui s’étirait par intermittence aux fenêtres, une tache blanche signalait une église en pierre, une grise, le toit d’ardoise d’un château. Le train glissait sur la plaine picarde5. ».
Au paysage extérieur se superpose un paysage intérieur, comme si l’auteur peignait en réalité une géographie du cœur. Sans pour autant verser dans la facilité d’un discours compassé, la morsure de la nostalgie se fait parfois sentir, invitant les personnages à éprouver la douleur d’un retour impossible et à la surmonter dans l’acceptation d’une perpétuelle nouveauté : « Le maire de Calais montait vers le nord et sentait à la douceur d’être où il s’engourdissait, malgré le bruit, le cahotement et le froid, combien ce bref séjour à Paris l’avait éloigné, retiré de son univers. Cette escapade à la capitale n’avait pas été désagréable. […] mais […] Paris avait changé. Plus que les modernisations du préfet Haussmann, plus que les ultimes traces des incendies de la Commune, l’avait rendu pensif ce qui demeurait. Les façades des vieux quartiers, les ponts sur le flot terreux de la Seine, les monuments anciens au bout des avenues nouvelles, tout ce qu’avait connu le bachelier débarquant du Pas-de-Calais, émerveillé, dévoré de désirs, lui disait que sa vie était écoulée au deux-tiers. Derrière le train, la faille du temps se refermait6. ».
Cet attachement à la terre comme à son Histoire s’arrime à un lien quasi charnel avec la langue. Michel Bernard assume pleinement un héritage classique qu’il revendique, s’effaçant parfois derrière la voix des Anciens. Ici, il fait entendre la complainte de François Villon et sa « Ballade des pendus » ; là, il s’éclipse derrière la sagesse de Jean de La Fontaine. Torrent qui bouillonne, qui s’amenuise parfois pour rejaillir plus loin et qui, toujours, remonte à la même source vive, la langue française devient objet de curiosité. De nombreux passages réflexifs se lisent comme une déclaration d’amour à une langue toujours mouvante, qui sait ce qu’elle doit aux parlers régionaux. Dans les chuintements rustiques du picard, Michel Bernard fait surgir les collines embrumées de l’Artois et amplifie le crépitement de ses averses : « Il savourait les sonorités d’un langage que des générations macérant entre des collines noyées de pluie d’un coin de l’Artois avaient patinées. Ces mots-là donnaient de la tendresse au monde qu’ils commentaient7… ».
Loin de l’assimiler à une vile altération de la langue, le romancier rappelle la culture littéraire du patois, en souligne la vigueur et en célèbre les racines. C’est un extrait des Chroniques de Jean Froissart qu’Omer Dewavrin délivre à Rodin, convaincu qu’en saisissant la langue pittoresque du chanoine, l’artiste saura exprimer la grandeur du geste des Bourgeois : « C’était une sorte de reportage, vivant, coloré, mais que le texte, en vieux français, rendait difficile d’accès. Le maire, qui comprenait le patois picard, […] se demandait ce que les Parisiens allaient y comprendre. Cette pensée l’amusait. Ils se débrouilleraient, cela contribuerait à les départager, et le plus motivé l’emporterait. Le barbu de la rue de l’Université, avec ses grosses mains et ses manières rustiques, ses silences et son marmonnement, paraissait mieux armé que le dandy rencontré l’après-midi. Il y avait du paysan chez ce Rodin8. ». De fait, le sculpteur est d’abord déconcerté par cette langue étrangère aux sonorités ruisselantes, dont il percera les secrets dans une scène incroyable, aidé de son ami Octave Mirbeau et d’un couple de Picards. Magie de la langue qui réunit autour d’une même table, sans plus aucune distinction de classe ni de fortune, un sculpteur bientôt célèbre, un journaliste féru d’art, un petit concierge et une ménagère illettrée.
Et c’est de cette femme, sachant « seulement signer son nom et lire les mots utiles9 » mais toujours intimement liée à une terre natale qui trouvait encore à s’exprimer dans ses propos « rustiques, […] truffés d’expressions chuintantes, aussi fluides et fusantes dans sa bouche qu’elles étaient opaques et sans mobilité dans l’esprit de Rodin10. », que viendra la révélation. Michel Bernard célèbre un savoir paysan, à la fois humble et authentique, vibrant héritier d’une terre et de sa mémoire. Innervée par la vivacité de sa langue « maternelle », la ménagère se métamorphose, comme si elle prenait enfin vie, et se met à défier le temps : « La femme s’animait au fil de la chronique. Sa réserve initiale, surtout inspirée par Mirbeau, ce monsieur aux yeux bleus impressionnants qu’elle ne connaissait pas, était entièrement tombée et sa bonne humeur avait pris le dessus. Mirbeau était fasciné, Rodin enchanté. […] Les siècles n’avaient pas eu plus d’effet sur son langage. […] L’histoire de la reddition de Calais au roi d’Angleterre, le 4 août 1347, achevait de sortir des limbes dans l’étroit rez-de-chaussée de Dépôt des Marbres11. ». Michel Bernard, qui connaît ses classiques, en revient aux fondamentaux : la puissance incantatoire de la langue et sa magie évocatrice. Quand dire, c’est voir et montrer : « Sa femme laissa le silence s’établir, avant de répéter, en y mettant de son gros accent la prononciation adéquate : « Vé nous chi six ! » Elle avait fait un geste pour accompagner sa parole, un ample mouvement circulaire, paume ouverte, doigts dépliés, d’une grâce, d’une noblesse surprenante. Alors, Rodin les vit, tous les six12. ».
Historien, géographe, écrivain, philosophe… Derrière la rigoureuse érudition du romancier, se cache un humaniste au regard empreint de tendresse pour ses personnages, à commencer par les fameux Bourgeois qui retrouvent un nom, un visage, une humanité, masqués jusqu’alors par la grandeur du sacrifice. Sous la gestuelle du sculpteur, se dessinent les traits touchants des personnalités : « Une de ses fréquentations parisiennes […] accepta de lui servir de modèle pour la tête d’Eustache de Saint-Pierre. […] Ces traits convenaient à l’idée que Rodin se faisait du premier des Bourgeois au nom d’apôtre. Un homme austère, très pieux, érudit, exégète des écritures saintes, gestionnaire avisé de sa fortune et premier donateur pour les œuvres charitables de l’Église, un citoyen intègre, réputé pour son sens de la justice et pour ces raisons arbitre reconnu des conflits locaux. Des six, il était le plus âgé. Rodin exagéra ses rides, accentua sa maigreur et courba sa tête habituée à la lecture. Le vieillard renonçait aux jours qui lui restaient à vivre, aux livres encore à lire ; ce n’était pas moins difficile que pour les autres. […] Dans les pas d’Eustache, il voyait Jean d’Aire, le plus puissant armateur de Calais. Premier embarquement à douze ans, à vingt il possédait un bateau, à trente, une flottille qui courait des côtes de Galice à celles du Jutland. Grand, des muscles durs, le verbe rare, un meneur d’hommes. Veuf, il avait deux filles ainées aimées tendrement. Il avait combattu les Anglais. Les deux frères de Wissant étaient plus jeunes, des fils de famille amateurs de soirées arrosées à la bière et au genièvre, coureurs de filles, qui s’étaient laissés vivre au début de la guerre. Ils s’étaient révélés pendant le siège en participant à la défense de la ville. Andrieu d’Andres et Jean de Fiennes demeuraient flous. Rodin attendait, confiant, que le temps les dessinât en lui13. ».
L’inerte monument de pierre prend chair et, avec lui, tous les oubliés de l’Histoire. En honorant de son récit Omer et Léontine Dewavrin, Michel Bernard réhabilite les hommes et les femmes de l’ombre, ces faiseurs d’Histoire méconnus du grand public. Inspiré par la correspondance entre Rodin et les époux Dewavrin, dont il reproduit des extraits en appendice de son roman, l’auteur salue l’opiniâtreté d’un couple sans qui l’œuvre d’art n’aurait jamais pu voir le jour. On pense bien évidemment à Omer Dewavrin dont la conviction de participer à la création de « quelque chose qui demeurerait14 » le conduit à surmonter les nombreux obstacles venus émailler dix années d’érection du monument ; mais on songe aussi à son épouse, la discrète Léontine, qui accorde une fois absolue au génie artistique de Rodin, et qui l’encourage à persévérer, en dépit des critiques.
Tout en finesse — voire en pudeur — le livre raconte la genèse d’une improbable amitié entre Auguste Rodin et le couple Dewavrin. Sans jamais basculer dans l’énoncé, Michel Bernard feutre les nuances de l’estime, mue en affection sincère. De fait, Les Bourgeois de Calais est un roman de l’intimité et de la profondeur qui nous laisse pénétrer les pensées des personnages, tissant ainsi entre eux un subtil dialogue sans paroles. L’artiste et l’homme d’état, quoique très opposés, se révèlent construits en miroir : les inquiétudes du premier se réverbèrent chez le second et les interrogations de l’un trouvent écho dans les doutes de l’autre.
Il en fallait peu pour transformer Rodin en personnage pittoresque. Trapu, myope, le visage mangé par une barbe fournie, ce virtuose — qui tient davantage du brave paysan que de l’artiste de salon — démontre pourtant une irrésistible éloquence lorsqu’il s’agit de création artistique. Visionnaire, Rodin détourne le projet initial de sa visée utilitariste et le sauve de l’instrumentalisation politique. L’œuvre, envisagée un temps par le maire comme un exemplum virtutis, dépasse la simple exhortation à imiter un ancestral courage civique et éveille en nous une compassion toute familière pour ces « frères humains ». Le sculpteur ne professe plus tant l’héroïsme individuel que la communion des hommes allant au-devant de leur mort, et c’est de cette proche intimité avec le spectateur, retrouvant dans les Bourgeois l’expression déchirante de sa propre condition humaine, que naît la grandiloquence de l’œuvre d’art.
Transcendé par son art, habité par ses visions, le charismatique sculpteur exerce sur Omer Dewavrin une incroyable fascination qui initie la métamorphose de l’édile et le fait progressivement sortir de la torpeur de son confort bourgeois pour pénétrer dans un monde autrement plus sensoriel. Au fil de ses rencontres avec Rodin, le commanditaire sent germer en lui un ineffable émoi qui semblait n’attendre qu’un catalyseur — l’émotion esthétique — pour se révéler. Le roman redonne son lustre à la sensibilité et à la perception sensorielle, qui sont autant de fenêtres ouvertes sur une autre vérité. Il sonde notre manière d’appréhender le monde et met l’accent sur notre attention esthétique, particulièrement sollicitée par les œuvres d’art mais aussi par tout ce qui compose notre vie sensible : un corps nu, un paysage, la page d’un ancien manuscrit, la sonorité d’une langue oubliée … L’écriture se fait sensuelle, la langue s’échauffe, s’étire avec souplesse, comme lorsqu’elle décrit les postures des figures sculptées, « [c]ertaines prostrées, d’autres accouplées, étirées, torturées, révoltées, toutes luttant avec la matière qui les aspirait, se nourrissait de leur corps15. ». Les blocs à tailler prennent forme et semblent s’animer. Corps de pierre et corps de chair appellent à la caresse et échauffent les sens comme l’imagination : « Rodin […] se déplaçait d’un côté à l’autre pour varier les points de vue et juger des effets de lumière, des ombres, celles projetées par les saillies, celles, plus profondes, stagnant dans les creux. Il les palpait, y plaçait les doigts. Le visiteur eut le sentiment que les battants allaient s’ouvrir sous l’effet d’un mécanisme secret et que lui serait bientôt révélé un mystère, en plein Paris16… ».
Rodin lui ayant montré la voie d’un nécessaire abandon, Omer Dewavrin peut alors s’ouvrir à l’inconnu. Lui qui « n’avait pas le goût du mystère, […] [qui] aimait le droit, la science, l’histoire, les raisonnements rigoureux, […] [et qui] se tenait pour un homme de sens pratique, positif et raisonnable […] sentait dans ce plâtre où l’on voyait les traces des doigts qu’il avait serrés, […] l’expression d’une vérité supérieure qui le dominait17. ». Sans plus chercher à intellectualiser une expérience qui le dépasse, le maire consent à se laisser bouleverser par la puissance de l’émotion esthétique, faisant, pour ainsi dire, un acte de foi.
Car ce qui se joue finalement à travers l’immanence de l’œuvre d’art, c’est un rapport à la transcendance et à une forme de sacré. Michel Bernard cherche à s’approcher au plus près du génie créateur, non pour en dévoiler les arcanes mais pour en célébrer les mystères. Son Rodin se fait voyant, devient cet autre rimbaldien et accepte lui aussi le caractère secret de l’Être. Ses mains, « prolongement mystérieux de son esprit18 » ne savent-elles pas mieux que lui comment donner vie à la matière inerte et trouver le moyen d’émouvoir ? Le génie ne se comprend pas, il se manifeste : « Parfois, il se demandait s’il était bien l’artiste qui avait sculpté ces six figures. Il n’aurait pas su les refaire, il ne savait plus comment il les avait faites. L’avait-il jamais su ? Son œuvre lui échappait19. ».
L’œuvre d’art devient un lieu absolu, où se réunissent et se confrontent les contraires, matière et idée, intériorité et extériorité, sensorialité et sublime, non pour chercher à se détruire, mais pour s’accorder en un harmonieux chaos. Au-delà de l’anecdote historique, le roman se fait trouée philosophique, invitation subtile à sonder la profondeur des êtres et des choses, rai de lumière projeté sur le caractère ineffable de l’Art et consentement à se laisser ravir par l’émotion esthétique. En tendant à montrer les choses en soi, ce qu’elles sont en surface comme en contrebas, Michel Bernard assigne à la littérature la mission de révéler une vérité intérieure. Il règle alors son pas sur celui de l’authentique Rodin qui concevait l’art comme un « plaisir de l’esprit qui pénètre la nature et qui y devine l’esprit dont elle est elle-même animée20. ».
Le mot de la fin
« Mais ces populations des côtes, qui tous les jours, bravent la colère de l’océan, n’ont pas peur de celle d’un homme. Il se trouva sur-le-champ, dans cette petite ville dépeuplée par la famine, six hommes de bonne volonté pour sauver les autres. Il s’en présente tous les jours autant et davantage dans les mauvais temps, pour sauver un vaisseau en danger. Cette grande action, j’en suis sûr, se fit tout simplement21 … ». Cet emprunt à Michelet prend une tout autre résonance, maintenant que se fait à nouveau entendre le martèlement mortifère des canons. On relit de même Les Bourgeois de Calais avec une nouvelle perspective, se laissant peut-être davantage toucher par ces hommes passés à la postérité et devenus héros, presque malgré eux.
Les six Bourgeois, Rodin ou encore Omer Dewavrin … les personnages qui intéressent Michel Bernard ont cela en commun de sortir de leur sillon pour se projeter dans l’extraordinaire. Qu’ils soient entrés dans l’Histoire ou qu’ils en soient sortis, oubliés sous la poussière du temps ; qu’ils se soient dressés contre la félonie ou qu’ils aient troublé notre regard par leur façon singulière de voir le monde, tous ont consenti, à leur façon, à s’abandonner à l’Inconnu, dans tout ce qu’il peut avoir de séduisant mais aussi d’inquiétant voire de menaçant.
Aux « fantômes immobiles » du passé, Michel Bernard préfère la vie bien vivante. Loin de circonscrire son roman au genre historique, il le laisse s’échapper, déborder de son enceinte, pour s’approcher tantôt de la fable humaniste, tantôt du récit philosophique. Ce faisant, il partage bien plus qu’une admiration extatique pour une oeuvre centenaire, mais il rappelle que la sculpture comme le roman, dans ce qu’ils ont à la fois d’insaisissable et de saisissant, nous invitent à nous élever et à nous montrer dignes de ce qu’il y a de plus noble en nous : notre humanité.
“Une fois qu’on a goûté à la beauté artistique, la vie change. Une fois qu’on a entendu chanter le coeur de Monteverdi, la vie change. Une fois qu’on a contemplé Vermeer, la vie change. Quand on a lu Proust, on n’est plus le même. […] L’art est une preuve d’amour donnée par l’artiste à l’humanité.”
J. Cabré, Confiteor, trad. E. Raillard, Actes Sud, 2016, p.487 et 492.
Les Bourgeois de Calais de Michel Bernard, éditions La Table Ronde, août 2021, 208p, 20,00€.
1 B. Lenoir, L’oeuvre d’art, GF Flammarion, 1999, p.87.
2 M. Bernard, Les Bourgeois de Calais, La Table Ronde, 2021, p.24-25.
3 Ibid., p.39.
4 Ibid., p.38-39.
5 Ibid., p.35.
6 Ibid., p.35-36.
7 Ibid., p.51.
8 Ibid., p.35.
9 Ibid., p.51.
10 Ibid., p.51.
11 Ibid., p.51-52.
12 Ibid., p.53.
13 Ibid., p.76-77.
14 Ibid., p.59.
15 Ibid., p.23.
16 Ibid., p.23.
17 Ibid., p.57.
18 Ibid., p.153.
19 Ibid., p.153.
20 A. Rodin, L’Art, Entretiens réunis par P. Gsell, Les cahiers Rouges, Grasset, 1911, p.12.